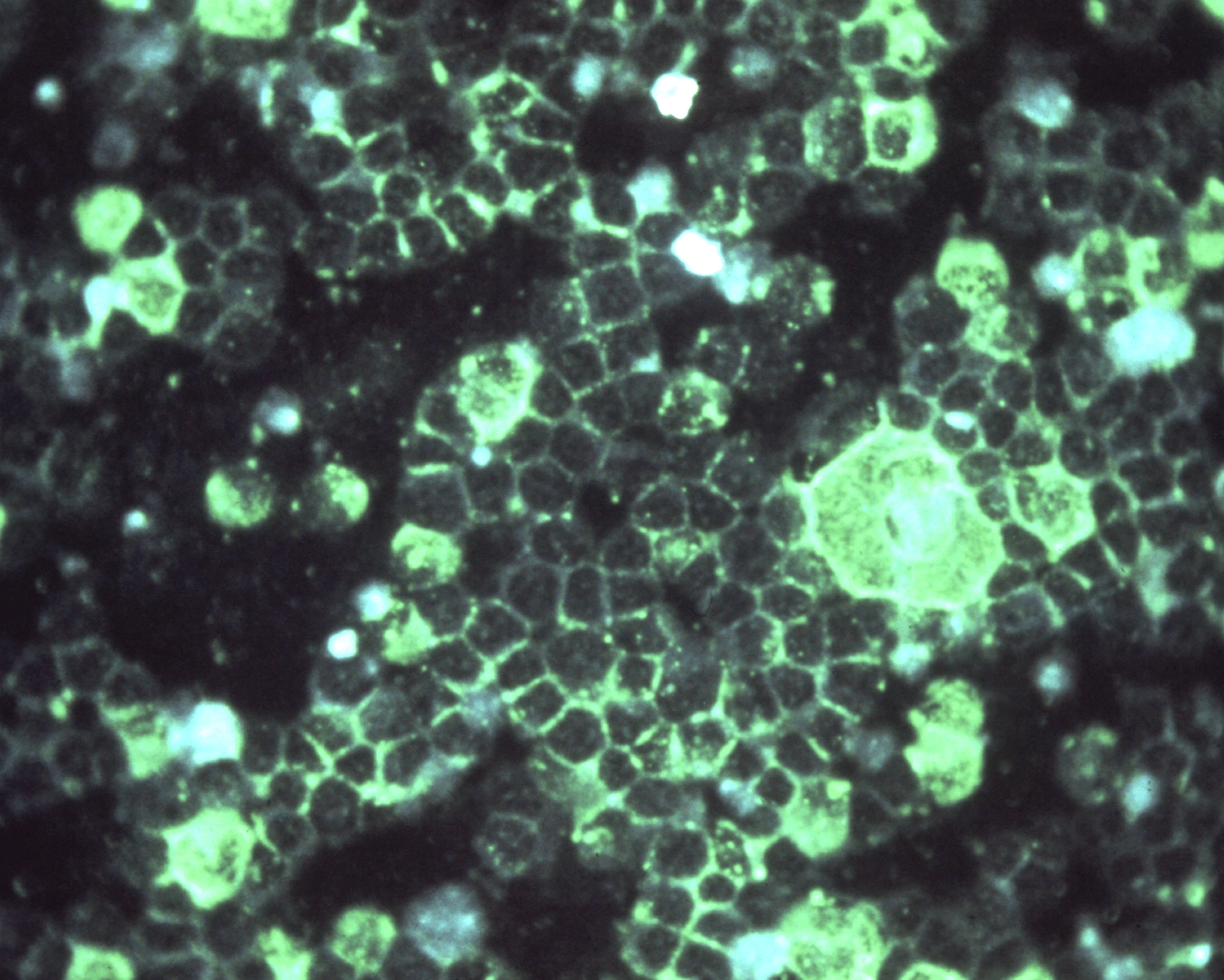Vaccination de la mère pendant la grossesse ou immunisation des enfants avec des anticorps monoclonaux
Généralement, les (futurs) parents peuvent et doivent choisir s’ils veulent protéger leur nouveau-né contre le VRS indirectement par une vaccination maternelle ou directement à la naissance avec des anticorps monoclonaux. Cette protection est essentielle pendant le semestre d’hiver, particulièrement pour tous les enfants de moins de 6 mois. Les recommandations suivantes indiquent les intervalles précis pour un timing optimal.
a) Vaccination de la mère pendant la grossesse
Le vaccin bivalent non adjuvanté contre le VRS (Abrysvo®) est destiné aux femmes enceintes dont les anticorps maternels vont protéger l’enfant au cours des premiers mois de sa vie contre les infections sévères des voies respiratoires inférieures (IVRI) aiguës dues au VRS et les hospitalisations liées au VRS.
La CFV et l’OFSP recommandent de vacciner les femmes enceintes à partir de 18 ans avec 1 dose d’Abrysvo®. Abrysvo® doit être proposé et administré entre les SG 32+0 et36+0 si le terme se situe entre début octobre et fin mars. La vaccination doit être planifiée et le vaccin administré au moins 14 jours avant la naissance.
b) Immunisation des nouveau-nés et des nourrissons avec des anticorps monoclonaux
Les anticorps monoclonaux à longue durée d’action constituent une alternative pour protéger les nouveau-nés et les nourrissons.
Le groupe d’experts recommande, en accord avec la CFV et l’OFSP, d’administrer à tous les nourrissons avant l’âge d’un an une dose unique d’un anticorps monoclonal (mAB) à longue durée d’action comme immunisation (passive) de base pour la prophylaxie des infections dues au VRS. Les nouveau-nés qui viennent au monde pendant la saison de VRS et dont la mère a reçu l’Abrysvo® pendant sa grossesse, sont en général considérés comme suffisamment protégés et n’ont pas besoin d’être immunisés avec des anticorps monoclonaux (cf. exceptions ci-après).
Les anticorps monoclonaux contre le VRS devraient être administrés comme suit :
Nouveau-nés nés entre octobre et mars → Administration d’une dose unique d’un mAB à longue durée d’action durant la 1re semaine de vie, idéalement à la sortie du service de maternité ou de néonatalogie, ou le plus tôt possible par la suite.
Nourrissons nés entre avril et septembre → Administration d’une dose unique en octobre, ou le plus tôt possible par la suite.
La dose de mAB peut être administrée en même temps que les vaccins courants (DTPa-IPV-Hib-HBV, PCV, anti-méningocoques, ROR, ROR-V), mais pas au même endroit (à une distance d’au moins 2,5 cm).
Idéalement, les futurs parents seront informés de ces deux possibilités de prévention, avant la naissance, par les gynécologues, sage-femmes, pédiatres et/ou médecins généralistes.
En complément, une seconde dose d’un mAB à longue durée d’action (nirsévimab : 200 mg, sous forme de 2 injections à 100 mg) est recommandée, en octobre, pour les enfants jusqu'à 24 mois qui, au début de leur 2e saison de VRS, présentent - selon appréciation du spécialiste traitant, une pathologie congénitale ou acquise associée à un risque élevé d’infection sévère à VRS de manière prolongée. Ces maladies comprennent entre autres :
- malformation cardiaque congénitale ou acquise hémodynamiquement significative (p. ex. cardiopathie cyanotique)
- hypertension artérielle pulmonaire
- pathologie pulmonaire chronique (telle que DBP modérée à sévère, malformation pulmonaire et mucoviscidose)
- troubles métaboliques congénitaux avec répercussion sur la fonction cardiaque ou pulmonaire
- pathologies neurologiques congénitales ou acquises (telle qu'une épilepsie et une infirmité motrice cérébrale) et maladies neuromusculaires
- immunodéficience (congénitale, acquise ou induite par des médicaments)
- syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques
- prématurité : âge gestationnel < 33 semaines
- autres maladies chroniques susceptibles d’entraîner une infection sévère à VRS (par ex. hépatopathie chronique et malformations d’organes).
Chez les enfants devant subir une opération cardiaque avec pontage cardio-pulmonaire, oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse, une dose supplémentaire d’un anticorps monoclonal à longue durée d’action est recommandée dès que l’enfant est stable en postopératoire, afin de garantir un taux sérique suffisant (https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/761328s000lbl.pdf et information professionnelle Beyfortus® (swissmedicinfo.ch).
Une contre-indication existe chez les enfants ayant présenté des réactions allergiques graves au nirsévimab ou à un composant du Beyfortus®.
Les anticorps monoclonaux ne doivent plus être administrés aux enfants ayant déjà contracté une infection à VRS au cours de la même saison. Exception : en cas de risque de perte d’immunité humorale (pontage cardio-pulmonaire, oxygénation par membrane extracorporelle).
En cas de disponibilité limitée des anticorps monoclonaux, les anticorps devraient être administrés en priorité aux enfants qui présentent un risque élevé d’hospitalisation en cas d'infection à VRS. Il s’agit des groupes de patients à haut risque mentionnés plus haut pendant leur 1re ou 2e saison de VRS.
Des anticorps monoclonaux pour les nourrissons de mères vaccinées contre le VRS ?
La vaccination de femmes enceintes offre, au cours des premiers mois de vie, une protection élevée contre les infections sévères des voies respiratoires inférieures nécessitant un traitement. Les nourrissons nés pendant la saison de VRS et dont la mère a reçu l’Abrysvo® pendant la grossesse sont en général considérés comme suffisamment protégés. C’est pourquoi l’administration de nirsévimab ne devrait être envisagée que dans des situations très précises où il existe un risque de transmission transplacentaire insuffisant d'anticorps (administration d’Abrysvo® moins de 14 jours avant l’accouchement, âge gestationnel < 37 semaines, immunosuppression maternelle, y c. infections par le VIH avec charge virale persistante), un risque de perte de l’immunité humorale (après pontage cardio-pulmonaire, oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse) ou - selon appréciation du spécialiste traitant - une comorbidité exposant à un risque d'infection à VRS potentiellement mortelle.